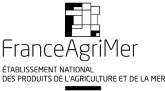Étude économique visant à éclairer la déprise laitière
Date de publication : 23/07/2025
Période concernée : 2020-2023
Auteurs : Ceresco et Idele pour le Cniel et l'Unité Élevage - SAEF - DMEP - FranceAgriMer
Objectifs
En 2023, dans un contexte de reflux des volumes et du nombre de points de collecte touchant les bassins historiques de la production laitière, FranceAgriMer et le Cniel ont commandé conjointement une étude visant à apporter un éclairage sur ces nouvelles dynamiques.
Méthodologie
Cette étude, réalisée par Ceresco et l’Institut de l’élevage, comporte deux volets :
- Le volet quantitatif a mobilisé des bases de données diverses : BDNI, recensement agricole, enquête des livraisons individuelles de lait de FranceAgriMer, fichiers de la MSA… Il a permis de sélectionner 3 zones d’intérêt, à approfondir en phase 2.
- Le second volet, qualitatif, a consisté en l’analyse d’entretiens réalisés auprès d’acteurs des zones identifiées dans le 1er volet. Au total, 20 organisations (centres de gestion, syndicats, organisations de producteurs, chambres d’agricultures, centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière - Criel…), 20 éleveurs et 10 laiteries ont été interrogés.
Résultats
L’analyse quantitative a permis d’identifier 4 profils d’arrêt de la production laitière : les arrêts dits « prévisibles », les « effets dominos », les départs précoces et les autres départs. Les analyses statistiques ont permis d’évaluer la force de différents facteurs sur la probabilité d’arrêt. Les effets « âge » et « taille du cheptel » ont été évalués comme forts : 86 % des arrêts avaient moins de vaches que la moyenne, et 72 % des exploitations avaient au moins un co-exploitant de plus de 55 ans. Certains systèmes de production sont également plus sensibles aux arrêts (ceux à dominante grandes cultures ou polyculture élevage par exemple). L’effet « collecteur » en tant que tel n’a pas été identifié comme facteur d’arrêt, mais un collecteur peut avoir un effet indirect, via le dynamisme de ses investissements d’une part et la traduction ou non d’un fort besoin de lait par les contrats auxquels il répond. L’analyse a permis de sélectionner 3 zones d’intérêt pour l’étude :
- La Vendée (85) : baisse marquée des livraisons, du cheptel et des exploitations, et ce malgré un contexte démographique favorable, avec une part importante de jeunes éleveurs.
- Zone « Bretagne » - Morbihan (56) et Finistère (29) : baisse des livraisons dans ces bassins historiques de production laitière, confrontés à un choc démographique important.
- Zone « Normandie-Mayenne » - Orne-Ouest/Sud-Manche/Nord-Mayenne : zone choisie pour déterminer les facteurs de maintien. Dans cette zone, la production est plus favorable, soutenue par des taux d’arrêts plus faibles et un meilleur taux de remplacement.
En Vendée, les difficultés liées à la main-d’œuvre et à la transmission sont prégnantes, alors que les possibilités de productions alternatives sont possibles, ce qui a pour effet la végétalisation de ce département. D’après les entretiens, « l’ambiance laitière » semble moins bonne que dans d’autres zones. Les collecteurs sont en retrait, même si le département possède des atouts sur l’aval, via la filière beurre AOP et les investissements de certains opérateurs. Dans la zone « Bretagne », le choc démographique, liée à la pyramide des âges plus fortement déséquilibrée qu’au niveau national, semble être le facteur principal de déprise, mais les alternatives à la production laitière et les problématiques de transmission ont aussi été identifiés comme participant à ce phénomène. Enfin, dans la zone « Normandie-Mayenne », « l’ambiance laitière » est meilleure. La zone centralise une partie des investissements, tant sur l’amont que sur l’aval. À la différence des autres zones, ici, peu d’autres productions semblent concurrencer le lait. Toutefois, la zone n’échappe pas aux difficultés de transmission, notamment dans un contexte d’agrandissements des exploitations.