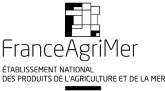Évaluation des ressources en biomasse aquatique disponibles en France & coproduits et sous-produits
Date de publication : 26/06/2025
Période concernée : 2018-2019, mise à jour 2025
Auteurs : Bioéconomie - DMEP - FranceAgriMer
L’état des lieux prend en compte l’ensemble des activités impliquées dans la bioéconomie bleue, soit : les activités de production ainsi que de mobilisation, transformation et utilisation de la biomasse issue du milieu aquatique, qu’il soit marin ou d’eau douce. L’élaboration de cet état des lieux s’est basée sur l’analyse de données et de la bibliographie existantes, ainsi que sur des entretiens.
Mise à jour de juin 2025
Objectifs
L’objectif de cet état des lieux est double : éclairer les acteurs économiques et enrichir l’Observatoire national des ressources en biomasse (ONRB) porté par FranceAgriMer en ce qui concerne l’importance des gisements et des usages de la biomasse issue des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et ainsi identifier des opportunités de développement de nouvelles filières de valorisation pour ces secteurs.
Méthodologie
L’état des lieux prend en compte l’ensemble des activités impliquées dans la bioéconomie bleue, soit : les activités de production ainsi que de mobilisation, transformation et utilisation de la biomasse issue du milieu aquatique, qu’il soit marin ou d’eau douce. L’élaboration de cet état des lieux s’est basée sur l’analyse de données et de la bibliographie existantes, ainsi que sur des entretiens. Les résultats préliminaires ont été consolidés et enrichis lors d’un atelier organisé par FranceAgriMer sur l’importance et les opportunités de développement de la bioéconomie bleue en France, ainsi que par une consultation par voie électronique. L’analyse de données a été initialement réalisée pour l’année 2018, année la plus récente pour laquelle l’ensemble des données était disponible. Des données plus récentes (2019) ont cependant également été mobilisées avant publication de l'étude. En 2025, une synthèse présentant des données mises à jour, équivalentes à celles déposées sur Visionet, est ajoutée en préambule des documents téléchargeables. Pour chaque espèce ou groupe d’espèces considéré, la représentation synthétique des flux et des volumes des chaînes de la production à la valorisation des coproduits s’est faite par l’intermédiaire de diagrammes de Sankey.
Résultats
La bioéconomie bleue en France métropolitaine se caractérise par sa grande diversité que ce soit par les volumes de biomasse des espèces considérées, la part des exportations et importations, ou l’importance (absolue et relative) des coproduits. Les importations sont par exemple deux fois plus importantes que la production pour plus de la moitié des espèces (par exemple, le cabillaud, le thon ou le saumon).
Au total, les volumes de coproduits (de natures très différentes) des filières bleues de la France métropolitaine sont estimés, pour 2018, à un peu plus de 210 000 tonnes par an. Très importants pour le saumon (84 400 tonnes), les huîtres (23 900 tonnes) ou le cabillaud (21 800 tonnes), les coproduits ne représentant que quelques dizaines à quelques centaines de tonnes pour d’autres espèces comme l’araignée de mer, l’esturgeon, le merlu commun ou la seiche. Rapportés à la production, les coproduits représentent de 40 à 60 % des volumes de produits pour le thon, l’églefin, le hareng, le maquereau, la moule, la petite roussette et l’esturgeon, mais moins de 10 % des volumes de produits pour le lieu, la lingue, le merlan, la seiche, la baudroie, la sardine, le merlu commun et l’araignée de mer. Les coproduits de cabillaud et de saumon sont clairement à distinguer du reste. Leurs volumes sont supérieurs aux volumes de la production française du fait de l’importance des importations pour ces espèces. La part la plus importante des coproduits est valorisée vers l’alimentation animale, que ce soit pour l’aquaculture, en petfood ou pour les animaux de rente. Une grande partie des coproduits est réutilisée en alimentation humaine, ainsi que ceux des espèces issues de la pisciculture et de la pêche. Les valorisations matières restent marginales, principalement en amendement minéral. Les espèces dont les coproduits ne sont pas ou que peu valorisés, sont principalement les espèces conchylicoles ainsi que les résidus de l’extraction d’algues.
Conclusion
Des potentiels importants de valorisation restent à saisir pour les filières moules, huîtres creuses, laminaires, coquilles Saint-Jacques et saumons que ce soit au regard de l’absence de valorisation actuelle, que de valorisations à faible valeur ajoutée ou encore de volumes totaux de coproduits importants mais qui restent à valoriser. Transformer ces potentiels en réalité demandera d’apporter des réponses adaptées aux contraintes organisationnelles, réglementaires, d’ordre logistique et de connaissances que rencontrent aujourd’hui les acteurs des filières, liées en particulier à l’atomisation géographique de la ressource avec quelques grands pôles sur le territoire, à la saisonnalité des produits , aux aléas de la pêche, au poids important de l’import dans les coproduits, à la grande diversité d’espèces, de groupes d’espèces (poissons, mollusques, crustacés, céphalopodes, algues) et de coproduits (partie molle, partie dure, minérale, ou encore organique), aux contraintes logistiques liées à cet éclatement de la ressource, aux difficultés de traçabilité et de constitution d’un réseau industriel sur le marché des invendus.