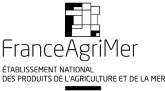Évaluation technico-économique de l'impact de la disparition des herbicides pour les productions des PPAM
Date de publication : 20/07/2022
Période concernée : 2021
Auteurs : Iteipmai pour Délégation nationale de Volx - SAEF - DMEP - FranceAgriMer
La gestion des adventices apparaissant comme une étape clé dans la réduction de la contamination aux alcaloïdes, l'étude liste les mesures de lutte et leurs surcoûts, dans le contexte de disparition des herbicides. Elle propose également des actions pour accompagner l'adaptation des exploitations, au risque de voir disparaitre certaines cultures.
Objectifs
Dans l'objectif d'évaluer les impacts technico-économiques des nouvelles exigences réglementaires pour un certain nombre de produits du secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, et alors que la disparition des herbicides rend plus difficile la maîtrise de l’enherbement, cette étude vise à déterminer les méthodes permettant de maîtriser les adventices, dans le but de limiter la teneur en alcaloïdes, et à chiffrer le coût de leur mise en œuvre.
Méthodologie
L’étude comporte trois volets : une recherche bibliographique sur les alcaloïdes (risques pour la santé, modes de contamination, réglementation,...), la réalisation d’une enquête auprès des exploitations et des entreprises de la filière, ainsi que d’organismes support de la filière (degré de connaissance des nouvelles normes réglementaires, estimation des impacts) et enfin la formulation d’hypothèses quant à d’autres voies de contamination possibles que la co-récolte, sur la base d’éléments de bibliographie et d’essais.
Résultats
Les alcaloïdes pyrrolizidiniques (APs) et les alcaloïdes tropaniques (ATs) sont des molécules qui se retrouvent naturellement dans certaines espèces végétales et qui peuvent s’avérer toxiques pour l’homme et certains animaux voire « potentiellement cancérogènes » en ce qui concerne les APs. Des contaminations par ces alcaloïdes ont été répertoriées dans différentes denrées alimentaires. Elles proviennent le plus souvent de la co-récolte d’adventices de cultures, productrices d’APs ou d’ATs.
Suite à diverses publications scientifiques intervenues depuis 2011, la Commission européenne a adopté en décembre 2020 un règlement fixant des teneurs maximales en APs pour certaines denrées alimentaires dont des PPAM (thé, plantes sèches, compléments alimentaire, etc.). Afin de permettre aux professionnels de s’adapter à ces normes, l’entrée en application du texte a été fixée au 1er juillet 2022, avec autorisation d’écouler jusqu’au 31 décembre 2023 les produits déjà sur le marché à cette date. Dans le même temps, le champ d’application du règlement relatif aux teneurs maximales en ATs s’est élargi aux infusions en 2021, avec entrée en application au 1er septembre 2022.
L’enquête conduite dans le cadre de l’étude a permis d’évaluer la connaissance par les acteurs de la filière PPAM de ces réglementations et les réponses envisagées pour faire face à ces nouvelles contraintes, afin d’en estimer l’impact technico-économique.
S’il a été observé globalement une méconnaissance des ATs, très certainement parce que peu d’acteurs sont confrontés à des contaminations, en outre peu réglementées jusqu’à présent en PPAM, la problématique des APs est beaucoup mieux connue des opérateurs. Ainsi, plus de 55 % des exploitations interrogées, représentant plus de 85 % des surfaces, connaissent bien les APs, même si tous ne savent pas citer de plantes qui en contiennent. De même, 60 % considèrent que les plantes à APs impactent leur activité, d’autant que près de 20 % ont déjà été confrontés à des refus de lots, mais la règlementation reste méconnue par une majorité d’exploitants. À noter que les 40 % de producteurs qui s’estiment non impactés pratiquent la vente directe (sans analyses) ou produisent des huiles essentielles (non concernées), et/ou exploitent des petites surfaces, ce qui permet un meilleur contrôle des adventices. Au niveau de l’aval, seuls 13 % des acteurs ne connaissent pas les APs et, si l’on excepte les opérateurs non concernés par la nouvelle réglementation, la quasi-totalité des entreprises estime que celle-ci va impacter leur activité, principalement du fait de difficultés d’approvisionnement. À noter que les entreprises s’estimant non impactées travaillent des produits non concernés par les textes (cosmétiques, huiles essentielles, etc.).
Face à la suppression des autorisations d’utilisation des herbicides, les réponses envisagées par l’amont consistent à limiter les adventices depuis la plantation jusqu’à la récolte ou la cueillette. Le désherbage apparaît ainsi comme une étape primordiale pour éviter les contaminations et engendre des frais supplémentaires en main-d’œuvre ou en mécanisation, auxquels il y a lieu d'ajouter le coût non négligeable des analyses. Les marges de manœuvre de l’aval sont moindres et se limitent, hors analyses, à des actions de prévention ou de formation auprès des fournisseurs.
Pour l’ensemble des acteurs, et avec des variables selon leur taille et leur capacité financière, l’étude pointe l’inquiétude de devoir, soit cesser son activité, soit abandonner certaines espèces, ainsi qu’un risque de dégradation des relations commerciales entre amont et aval. Les acteurs interrogés ont également proposé un certain nombre d’actions permettant d’aider la filière à s’adapter aux nouvelles réglementations : la formation sur les APs et leur réglementation ainsi que sur les techniques culturales plus adaptées, le lobbying politique en vue d’une modification des textes, les subventions publiques permettant d’atténuer les surcoûts engendrés par le respect des normes, la recherche scientifique pour mieux connaître les APs et leur impact sur la santé, le développement d’ outils ou de pratiques pour réduire les adventices, la mise en réseau des acteurs, des pratiques et de la réglementation. L’appui aux petites exploitations dans le cadre de politiques publiques et la mise en place d’une assurance de risque de contamination ont aussi été évoqués.
Enfin, et face au constat de la présence importante d’APs sur des cultures implantées dans des parcelles parfaitement désherbées, le troisième volet de l’étude explore un certain nombre d’hypothèses de contaminations non visibles, dont le purin de consoude, le pollen et le sol.