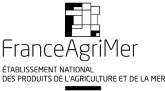Les métiers de l'herboristerie
Date de publication : 04/02/2019
Période concernée : 2018
Auteurs : FFEH pour FranceAgriMer
Les nouvelles attentes des consommateurs profitent au développement de l'herboristerie contemporaine, qui doit s'intégrer dans un cadre juridique contraint. Ses métiers, exercés par des passionnés, reflètent plus un mode d'existence qu'un schéma économique classique charges/produits/résultat.
Objectifs
A l'heure où l'herboristerie suscite un intérêt croissant de la part d'une partie de la population et alors que le métier d'herboriste reste non reconnu par l'Etat depuis la suppression du certificat afférent en 1941, l'étude vise à répertorier les activités et les pratiques qui gravitent autour de cette notion, afin d'évaluer l'impact qu'aurait une ouverture de la réglementation sur l'accès à la profession.
Méthodologie
Après une revue de la littérature scientifique, faisant le point sur l'image de l'herboriste telle que renvoyée par les auteurs, l'étude s'attache à cerner la pratique des activités herboristiques ainsi que leur impact économique au moyen principalement d'une enquête de terrain confrontée à une recherche bibliographique classique et à des dires d'expert.
Résultats
le métier d'herboriste, marginalisé par la littérature scientifique, peut-être du fait de son manque de légitimité, y apparait comme une activité secondaire voire dangereuse, témoignage d'analyses souvent simplistes. Cependant, certaines recherches plus récentes semblent objectiver davantage le sujet, en modifiant cette image négative d'autant moins généralisable que la réalité montre une multiplicité d'activités pouvant se revendiquer de la pratique herboristique.
En effet, la suppression du certificat d'herboriste mais aussi l'existence d'un monopole pharmaceutique (à l'exception des 148 plantes libérées mais qui restent interdites d'allégations de santé en dehors de l'officine) conduit le praticien en terrain mouvant. Néanmoins, il partage souvent des valeurs communes avec ses pairs, se revendiquant de trois mouvements sociaux d'envergure que sont la prise de conscience environnementale, la volonté de prendre en main sa santé et la recherche de racines, et est souvent arrivé dans le métier après une reconversion. On peut ainsi profiler quatre types de professionnels, souvent combinés : le paysan herboriste, qui cultive, cueille, transforme et vend ses plantes, l'herboriste de comptoir, revendeur et installé dans une boutique le plus souvent en ville, l'herboriste de cabinet, qui se positionne comme un thérapeute du fait de la possession d'un diplôme autorisé (naturopathe, diététicien,...) et l'herboriste formateur, qui organise des ateliers, des visites et transmet un savoir. Ces praticiens ont un âge moyen de 43,5 ans, sont de sexe féminin pour 70% et le plus souvent diplômés.
L'herboriste s'inscrit ainsi dans un modèle économique en développement, du fait des attentes croissantes de la population, qui se traduit par une production et des ventes de plantes médicinales en expansion en France, tout particulièrement à destination des compléments alimentaires (incluant les infusions) et des huiles essentielles. Ce modèle est économiquement concentré sur des petites structures et un territoire restreint ; il revendique une qualité supérieure de produits alliée au conseil rendu. Il est cependant perçu comme peu rémunérateur eu égard au temps passé par l'herboriste et aux investissements nécessaires (matériel de transformation et de conditionnement), soit parce que le prix unitaire du produit reste bas, soit parce que la durée d'utilisation est longue. Une des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires consiste à diversifier ses produits ou ses services, afin de parvenir plus sereinement au temps du retour sur investissement.