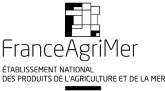Filières végétales
Autres : fibres textiles, tabac, truffe, houblon, ...
Bois
Céréales
Fruits, légumes et pommes de terre
Horticulture
Huile d'olive et olives de table
Oléo-protéagineux
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Semences
Sucre
Vigne, vin, cidre et spiritueux
PARSADA - Appel à projets 2025
Publié le 26/06/2025
Disponible du 30/06/2025 au 31/12/2026